Le rapport « Espace public : comment faire cohabiter nos mobilités » vient de paraître. Commandé par le Service Mobilité de la Métropole de Lyon à la Direction de la Prospective et du Débat Public, il est le second opus d’une série de 4 décryptages de la rue de demain (à paraitre) avec Isabelle Baraud Serfaty (ibicity) et Nicolas Nova (Near Future Laboratoy).
Dans ce travail, j’interroge les différentes revendications grandissantes sur la rue et qui dépassent la seule question des mobilités. D’une part, les usagers mobiles défendent leur mode de déplacement dans le partage de la rue, d’autre part, les riverains défendent la rue comme cadre de vie avec la mobilité en point de mire. Si les premiers et les seconds peuvent se confondre, changeant de statut selon le contexte, il reste que les positions se crispent de plus en plus et que le besoin d’espaces de dialogue sur la mobilité pour les prendre en compte et les réduire est nécessaire.
D’autant plus que les représentations et revendications sur le partage de la rue évolue avec les transformations des modes de déplacement dans un débat continu. L’opposition caricaturale de la voiture contre le reste des modes est de plus en plus caricaturale et reste assez figée alors que la voiture thermique côtoie de nouveaux véhicules quatre roues motorisés d’une part, et que les micromobilités sont de plus en plus hétérogènes et de moins en moins micro d’autre part.
Pourtant, il n’y qu’une seule rue alors que les pratiques se multiplient : quelles lignes de partage ? Séparer ou mélanger les modes de déplacement ? Ces deux solutions ne peuvent-elles pas coexister dans un même territoire au-delà des anathème ? Peu à peu, se dessine le début d’une nouvelle philosophie sociale de la rue qui requestionne la valeur de la vitesse par exemple. Et on pourrait assister à un retour en grâce des plans de circulation.
Dans les logiques de partage, certains avancent la solution numérique. Je propose alors d’en explorer un peu les enjeux et limites et les approches de la ville qui se cachent derrière. La contribution captées des corps mobiles via le numérique est-il un outil de régulation du partage de la rue de demain comme les autres ? Les services numériques et les algorithmes de gestion des mobilités portent une vision très individu-centrée de la rue et les dashboard global, agrégateur géant, jumeau numérique, un idéal de régulation collective des mobilités pour un partage fluide des rues. Quels modèles à venir ?
- Une contribution volontaire dans une visée d’intérêt général : demain, l’usager en mobilité sera-t-il invité, et sous quelles conditions, à partager ses données comme un nouveau devoir civique de construction du bien commun ?
- Une optimisation des données numériques dans une vision atomistique des individus demain, l’optimisation des mobilités de chaque individu « pilote » pour réguler et organiser la complexité des mobilités urbaines va-t-elle amener à une gestion centralisée, adaptée à chaque situation, quitte à aller vers un accès différencié à la rue selon les revenus, le statut, la réputation numérique ?
- Une dissimulation de la captation numérique : demain, l’individu mobile évoluera-t-il dans un univers informationnel omniprésent et invisibilisé remettant en cause l’idée même d’usage conscient du numérique et questionnant son libre-arbitre dans leur rapport qu’il entretient avec la ville ?
- Une affirmation d’un droit de se déplacer anonymement à rebours d’usages numérique intensifs : demain, avec la résistance croissante contre la captation des données individuelles, verra-t-on se légitimer la possibilité laissée à l’individu de redevenir anonyme dans la rue pour retrouver une certaine liberté d’appropriation et de mouvement ?
Municipalisme des communs ou Smart City tournée vers l’intérêt général : quel nouveau contrat social de la rue ?
Bonne lecture !
Par Benjamin Pradel, le 14 mai 2021
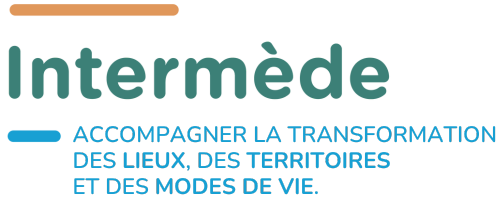
0 commentaires