
Le rapport « Aux rythmes de la ville, l’urbanisme dynamique » vient de paraître. Commandé par le Service Mobilité de la Métropole de Lyon à la Direction de la Prospective et du Débat Public, il est le premier opus d’une série de 4 décryptages de la rue de demain (à paraitre) avec Isabelle Baraud Serfaty (ibicity) et Nicolas Nova (Near Future Laboratoy).
Dans ce rapport, j’interroge et développe trois concepts existants pour appréhender la rue et ses aménagements à travers la question temporelle (Cadre Temporel, Chronostyle et Vitesse) et propose une revue de 7 catégories d’aménagements des rues analysé à travers le prisme temporel. Pas d’approche normative ou prescriptive, autre que celle de prendre en compte le temps, mais un décryptage de différentes manières d’envisager la question dans l’organisation des villes.
L’urbanisme dynamique comme piste d’aménagement temporel des rues
L’urbanisme dynamique prend en compte les rythmes urbains comme une donnée et un outil pour organiser et aménager globalement la ville, et plus particulièrement les rues. Plusieurs signaux faibles laissent penser qu’il va, dans les années à venir, apparaître comme un mode d’agir sur les mobilités, dans le cadre d’une rue contrainte spatialement, tant pour les faire cohabiter que pour les sélectionner.
La prise en compte du temps dans l’organisation des rues et des mobilités pourrait ainsi devenir une technique d’aménagement au même titre que le zonage (hiérarchie du réseau viaire), la spécialisation (plateau piéton), la superposition (urbanisme de dalle) ou encore la juxtaposition (boulevard urbains) des fonctions de la voirie.
Analyser et prendre en compte les rythmes urbains pour organiser les mobilités
L’urbanisme dynamique cherche pour partie à influencer les rythmes urbains, notamment issus des déplacements (vitesse, fréquence, pic d’affluence, embouteillage, vacance des stationnements, etc.) et pour une autre partie à s’y adapter en prenant en compte plusieurs dimensions du temps :
- les cadres temporels qui régissent les systèmes horaires de fonctionnement des villes (horaires des commerces, des transports, des festivités, etc.) ;
- les chronostyles (Rouch) qui rendent compte des rythmes des habitants dans leurs manières d’organiser leurs temps selon des variables sociodémographiques (âge, genre, revenu, localisation, niveau de diplôme, statut professionnel, etc.) ;
- les vitesses qui se glissent entre cadres et chronostyles comme une modalité d’accès à la ville avec, comme critère premier d’efficacité perçue, la rapidité individuelle.
Après des décennies de croyance dans l’idée de fluidité et de vitesse des déplacements, l’urbanisme dynamique invite à penser la malléabilité et les rythmes des rues selon les besoins localisés, micro, et les besoins, macro, de l’organisation globale du réseau viaire. La rue est alors de moins en moins considérée comme un objet statique, aménagée une fois pour toute, mais davantage comme un objet dynamique dont les modifications possibles sont envisagées suivant trois logiques d’action :
- la contrainte (fermer les rues aux voitures le dimanche en centre-ville),
- l’opportunité (développer des bus de nuit jusque dans les périphéries urbaines),
- le laisser-faire (ne pas agir sur les embouteillages pour inciter à un report modal, laisser s’installer les rythmes des saisons).
Sept « modèles de rue » de l’urbanisme dynamique
L’étude revient sur sept modèles de rue où s’applique une prise en compte des rythmes. Mises bout à bout, ces logiques de régulation temporelle révèlent un mouvement global qui consiste à penser autrement l’organisation de la voirie par un arbitrage, selon les besoins et les lieux, entre différents modèles d’action : lâcher-prise ou contrôle, temps réel ou programmation, vitesse ou lenteur, long terme ou court terme.
- « Rue de crise » – planification et système alternatif
- « Rue temporaire » – réorganisation des mobilités à court terme
- « Rue transitoire » – de l’expérimentation à la réorganisation pérenne des mobilités
- « Rue modulaire » – adaptation des rues selon des temps identifiés
- « Rue dynamique » – évolution de la Smart Street en temps réel
- « Rue lente » – déconnexion et décélération
- « Rue climatique » – cycle et temps long de la nature
Demain, l’application de ces différents modèles de rue à diverses échelles du réseau viaire pourrait il dessiner une planification temporelle systématique au service d’un nouveau partage de la rue et d’une organisation des mobilités ?
Pour aller plus loin : « Aux rythmes de la ville, l’urbanisme dynamique«
Par Benjamin Pradel, le 5 mai 2021
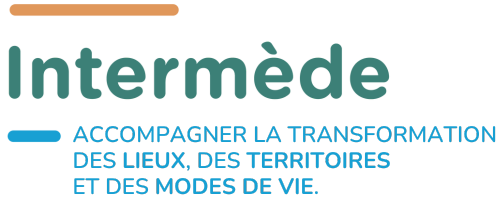
0 commentaires