Ce développement est la conclusion de l’état de l’art L’économie circulaire à hauteur d’habitant, rédigé pour Leroy Merlin Source et disponible en ligne : https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/leconomie-circulaire-a-hauteur-dhabitant/
L’économie circulaire et la consommation responsable sont deux concepts imbriqués pour un développement plus soutenable dans un système économique donné. Comme pratiques, elles se structurent dans des filières industrielles et tertiaires qui émergent ou mutent pour en organiser une offre de service auprès des habitants, collectivités, entreprises, etc. D’une part, l’offre de produits fabriqués de façon éthique dans le respect de l’être humain et/ou de façon écologique dans le respect du milieu, doit faciliter une consommation plus responsable. D’autre part, cette consommation doit s’inscrire dans une économie circulaire, en prolongement d’un système de production engagé à réduire ses déchets et à les revaloriser en bout de chaîne. Cette économie circulaire prend des visages multiples et s’organise en nouvelles filières : les circuits de recyclage, les plateformes de réemploi, le marché de l’occasion, les services de réparation, les offres de location et de partage des biens…
Ce modèle d’une économie plus responsable et circulaire s’oppose, en théorie, à celui d’une consommation massive et d’une production jetable qui s’appuient sur l’accumulation et la croissance comme mode de développement et qui jouit de tout un support infrastructurel puissant pour tenir : publicité, réseaux de distribution, concurrence des prix, assurance des produits, obsolescence programmée, etc.

Le garage, un lieu pour stocker des choses « au cas où »
Entre les modèles et les filières, l’habitant ordinaire s’organise au quotidien pour répondre à ses besoins via la consommation, comme il le peut, avec ses moyens, au plus proche de ses valeurs. L’acte de consommation reste un acte ostentatoire et de distinction mais pris dans de nouvelles hiérarchies de valeurs dans lesquelles la santé, l’éthique, l’écologie prennent de plus en plus d’importance. Pour autant, pris dans des déterminismes économiques, sociaux, culturels, géographiques, technologiques, l’habitant compose et arbitre ses choix de consommation. Il est désormais la cible de multiples messages qui l’appellent à se responsabiliser. Mais il sait qu’il ne peut être aussi vertueux dans chacun des domaines que ces messages lui proposent d’investir, voire lui enjoignent de soutenir, en suivant des normes de consommation valorisées : consommer les labels, réparer ses appareils, louer plutôt qu’acheter, acheter local, faire durer les objets, réduire ses déchets, se désencombrer des objets, acheter moins, etc. La consommation qui s’enrichit de nouveaux enjeux dépasse le seul acte d’achat pour créer un continuum avec l’acte d’utilisation qui vient alimenter ces filières de la circularité : bien trier ses déchets pour faciliter le recyclage ; faire réparer pour prolonger la vie des objets ; utiliser à bon escient selon les recommandations et notices ; acheter et vendre d’occasion sur les marketplaces, etc.
La consommation et l’utilisation responsable drainent alors une richesse d’imaginaires et de valeurs qui se donnent à voir comme un fait social total concernant toutes les strates de la société. Le sens porté par ces concepts semble très homogène pour aller tous ensemble dans la seule direction commune souhaitable, celle d’un développement plus durable de nos sociétés. Pourtant, ce sens n’est pas si simple à saisir et les débats et contradictions peuvent freiner les bonnes pratiques : climatosceptiscisme lattent porté par des discours médiatisés, injustices sociales perçues dans la mise en place de dispositifs environnementaux (ex. Zones à Faibles Emission), défiance dans les filières (ex. traitement du bac jaune de recyclage), méfiance dans la bonne volonté du système industriel (ex. obsolescence programmée) ou encore paradoxe apparent d’un développement durable dans le cadre de limites planétaires finies.
Dans ce contexte, suivre les bonnes pratiques recommandées n’est pas chose simple. D’une part, il faut croire un récit cohérent dans lequel les pratiques individuelles peuvent changer les choses à grande échelle au risque de placer de plus en plus de personnes en situation d’éco-anxiété. D’autre part, il faut pouvoir appliquer ces pratiques au quotidien dans un contexte de fortes contraintes, notamment budgétaires, en faisant des efforts pour y parvenir sans questionner sans cesse leur bien fondée. Sommé d’être un « bon consommateur » et un « bon utilisateur », l’habitant peut ainsi développer une forme de stress, augmenté par son impossibilité à combler le « green gap » qui s’ouvre entre les enjeux planétaires et climatiques exposés, les pratiques vertueuses recommandées et attendues et les possibilités de les appliquer et les incarner au quotidien. Derrière les nouvelles normes de consommation fondées sur la responsabilité et l’initiative en matière de durabilité environnementale se dessine une possible nouvelle fatigue d’être soi (Ehrenberg, 1998), contrepartie de l’énergie que chacun doit mobiliser pour devenir soi-même dans un monde devant faire face à un enjeu bioclimatique de premier ordre.

Jouer avec les matériaux pour créer un nouveau jeu
Dans le creux de concepts ou de termes à la mode et connotés positivement (circulaire, responsable, durable, éthique, local, partagé, collaboratif, etc.), l’habitant déploie des pratiques contrastées qui forment son équation personnelle au quotidien. Certaines sont au cœur de cette logique de circularité et de responsabilité mais ne sont pas reconnues comme telles dans le récit de l’économie circulaire et de la consommation responsables. En effet, ces pratiques « sous le radar » ne sont pas prises en main par les filières et difficilement identifiables et massifiables dans une logique économique. Déployées entre les quatre murs des logements, ces pratiques domestiques travaillent le déchet et la ressource en amont des boucles de circularité. L’habitant loueur à son voisin contre un coup de main à venir, l’habitant (sur/re)cycleur dans son garage de ses déchets domestiques, l’habitant réparateur dans son répair café le samedi après-midi, l’habitant réemployeur qui récupère dans la rue en se baladant…
Ces pratiques circulaires et durables démontrent que l’utilisation, voire les utilisations sur le temps long d’un même objet ou de ses composants, participe de la consommation, alors que celle-ci est trop souvent réduite à l’acte d’achat, considérée comme un acte isolé dans une relation asymétrique. Ces pratiques qui tendent à épuiser l’usage de l’objet sont à l’origine modestes, populaires et rurales. Elles viennent aujourd’hui enrichir le périmètre d’une économie circulaire et durable qui ne se limite plus seulement à des concepts nouveaux, urbains et technocratiques. Aux côtés de l’économie circulaire des filières monétarisées s’en déploie une autre dans des pratiques sensibles du quotidien. Une petite économie circulaire en quelque sorte.

La récup’ de composants ordinaires, ici des élastiques de chaussettes
La non prise en compte de cette petite économie circulaire, souvent déconsidérée, est aujourd’hui questionnée notamment face aux fortes inégalités sociales qui apparaissent dans l’appropriation des gestes et attitudes de consommation prescrites et valorisées. Les plus vertueux sont-ils bien ceux que l’on croit ? Entre sobriété choisie dans sa consommation, sobriété contrainte par le budget des ménages et sobriété intégrée à un mode de vie assumé, les pratiques responsables se nichent à différentes échelles de la hiérarchie sociale. L’analyse des ressorts socioéconomiques et cadres spatiotemporelles de ces pratiques de bricolages au quotidien permettant de faire vivre les objets et de réduire la consommation dans le monde marchand, la compréhension du braconnage consistant à renverser la seule logique utilitariste du rapport aux objets dans un monde rationnel, n’ont jamais été plus pertinentes qu’aujourd’hui pour envisager les enjeux de développement durable.
Dans la réparation et le bricolage seul au fond du garage ou entre copains au repair café, dans le réemploi d’objets pour soi ou pour d’autres pour arrondir les fins de mois, dans la réutilisation créative ou pour ne pas gâcher au quotidien, dans la revente ou dans le don à son voisin, sur des plateformes où chacun se dépatouille ou dans les brocantes du week-end dans le champ d’à côté, dans des pratiques domestiques de petit bidouillage entre plaisir et nécessité de faire, il est aujourd’hui nécessaire de considérer dans toute sa complexité cette petite économie circulaire, celle d’un habitant qui se fait (trop) souvent taper sur les doigts parce qu’il n’est pas assez conforme ou performant dans la logique des grandes filières de la circularité et des normes de la responsabilité.
Par Benjamin Pradel, le 06 mai 2025
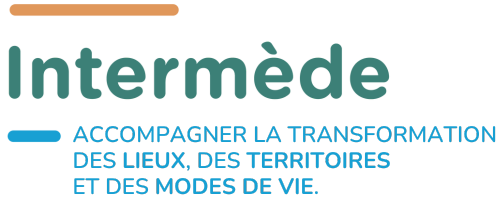
0 commentaires